Les confréries ont constitué pendant des siècles un tissu conjonctif dans notre pays, entre esprit dévotionnel, religion et laïcité. Voici lesquels sont les plus importants.
Index
Les confréries de l’Église catholique sont des associations publiques de fidèles qui se dédient principalement au service liturgique, à l’incrément du culte public et à l’exercice d’œuvres de charité, de pénitence et de catéchèse. Une autre des occupations à laquelle les confréries se dédient est la promotion d’une plus grande participation des fidèles à la liturgie et à la prière commune. L’objectif principal et distinctif de ces associations est donc le service liturgique, qui comprend le remplacement des servants d’autel pendant les célébrations eucharistiques, ainsi que la présidence et le guide de la liturgie des heures.
Les confréries peuvent également être impliquées dans l’exercice d’œuvres de pénitence, comme des pratiques de jeûne, prière et mortification, afin de grandir dans la vie spirituelle.
Enfin, les confréries jouent un rôle important dans la diffusion de la catéchèse, en promouvant la formation religieuse et spirituelle des fidèles à travers l’enseignement de la doctrine catholique.
Ces associations sont règlementées par les canons 298 et suivants du Code de droit canonique en vigueur.

Faire l’aumône : est-ce de la charité ?
L’aumône est strictement liée aux devoirs d’un bon chrétien. Dans une certaine mesure, il s’agit également d’une forme de justice.
Dans l’antiquité, il existait des associations comparables aux Confréries : les Disciplines. Elles prenaient leur nom de la Disciplina, un fouet utilisé comme instrument de pénitence corporelle. Sa fonction était celle de « se discipliner », i.e. se fouetter les épaules et le dos comme forme d’expiation pour ses propres fautes et comme acte de supplication pour obtenir la miséricorde divine.
Pendant l’époque carolingienne, à partir du VIIIe siècle, les confréries connurent un fort développement en France et dans le reste de l’Europe. Il s’agissait d’associations mixtes, qui impliquaient de manière égale des consacrés et des laïcs. Souvent, en effet, les disciplini, ou disciplinati, n’étaient ni frères ni moines, mais laïcs qui maintenaient leur vie familiale et professionnelle. Toutefois, ils observaient une « règle » et essayaient de poursuivre la perfection de la vie chrétienne propre des ordres monastiques et conventuels. Bien à l’avance par rapport aux ordres religieux qui se seraient formés ensuite, ils pratiquaient des œuvres de charité et de miséricorde, en construisant des hôpitaux, des maisons d’accueil, des auberges, des cimetières et des oratoires, et s’engageaient dans l’incrément du culte public et de la pitié populaire, avec des œuvres d’assistance aux malades, hospitalité aux voyageurs, suffrage des défunts, mais aussi aumônes pour les orphelins et les veuves et assistance religieuse aux condamnés à mort et aux détenus. Souvent, les membres de ces associations choisissaient même de vivre ensemble, exactement comme dans un ordre religieux.

Au Moyen Âge, ces formes de participation des citoyens à la vie religieuse prirent une identité plus définie. Au XIIIe siècle, elles se répandirent dans toute l’Europe comme un véritable tissu conjonctif de la société, où la motivation religieuse s’accompagnait souvent au besoin de considération sociale et de sécurité. Il est possible d’identifier au moins quatre types de confréries :
- confréries de dévotion, qui regroupaient tous ceux qui étaient attirés par la même forme de pitié, comme le culte de l’Eucharistie ou du Saint Rosaire, par exemple ;
- confréries des pénitents, comme la Compagnie des Disciplinati ou les Flagellants ;
- confréries de métier, comme les ainsi nommés Arts, unissaient les membres d’une même profession autour du culte de leur saint patron ;
- confréries caritatives, qui offraient des services spécifiques d’assistance, comme la gestion des hôpitaux et le soin des défunts.
Du point de vue religieux, les confréries représentaient l’effort des laïcs de trouver un espace entre la hiérarchie ecclésiastique, les moines et le peuple des fidèles. L’importance des confréries continua de croître au cours du temps, en les transformant rapidement en centres de pouvoir indépendants de l’autorité épiscopale. Même les ordres religieux commencèrent à montrer de l’intérêt pour le phénomène et certaines confréries furent instituées par des moines, comme les confréries du Carme des frères carmélites, les confréries de la Ceinture des ermites de Saint Augustin, les confréries du Rosaires promues par les Dominicains.

Vers la moitié du XIIIe siècle, en Italie centrale, se vérifia également l’émergence du mouvement connu comme les flagellants. À ce mouvement adhéraient de nombreux membres d’ordres religieux et confréries. Le mouvement était caractérisé par l’organisation de processions qui traversaient les villes, pendant lesquelles les pénitents frappaient leurs corps jusqu’à saigner. L’objectif de ces actions était d’expier les péchés de l’époque et de préparer l’avènement d’un nouveau règne spirituel. Les confréries organisaient aussi des processions dédiées aux saints, à la Sainte Vierge et au Christ, et certaines étaient très sanglantes, comme celles dans lesquelles on évoquait la Passion.
Ces représentations se transformèrent avec le temps, en donnant vie aux Représentations Sacrées médiévales, des œuvres théâtrales à caractère religieux souvent interprétées par les membres mêmes des Confréries. En particulier, ces associations promouvaient le culte de la Très-Sainte Eucharistie et organisaient des processions eucharistiques, pendant lesquelles ils transportaient des dais, des torches, des encensoirs et guidaient les moments de prière.

Pendant la Contre-réforme, le rôle liturgique des Confréries grandit. Le Concile de Trente transforma la culture pénitentielle, en la rendant plus spirituelle et en réduisant la pratique de la flagellation. Les confréries, surtout celles de la Ligurie, adoptèrent de nouvelles règles plus précises et assumèrent de nouvelles tâches, en allant combler le vide qui était venu se créer dans la dévotion populaire. Avec le temps, certaines Confréries adoptèrent un habit liturgique spécifique et furent investies de privilèges spéciaux, qui confirmaient leur importance dans la vie religieuse et sociale de l’époque. Si, au début, les confrères portaient des habits modestes et des capuches blanches, au XVIe siècle, même avec la diminution du phénomène de la flagellation, on assista à un enrichissement de leur habillement. Furent introduis des habits en satin et des tissus précieux, souvent brodés d’or et d’argent.
Les confréries les plus populaires au XVIe siècle étaient celles dédiées à la dévotion mariale, surtout après que Pape Pie V attribua la victoire de la Sainte Ligue contre les Turcs dans la bataille de Lépante à l’intercession de Marie. Avec l’augmentation de la vénération mariale, de plus en plus de confréries liées à cette dévotion virent le jour.
Après la suppression due aux décrets napoléoniens, et la confiscation des tous les biens des associés, seules les confréries avec un caractères strictement religieux réussirent à survivre et à reprendre ensuite leurs activités.
Non reconnues dans un premier lieu par la législation italienne comme entités religieuses, elles connurent des vicissitudes et réglementations diverses, jusqu’à ce que, le 28 juin 1934, on leur concéda la personnalité juridique, en reconnaissant ainsi leur existence légale.

Titres Mariaux : combien et lesquels sont les noms dédiés à Marie
Toutes les appellations avec lesquelles on vénère Marie, mère de Jésus: combien sont-ils? D’où viennent-ils ?
Comment fonctionne une Confrérie
Les normes ecclésiastiques qui règlent les confréries se trouvent inscrites dans le Code de Droit Canonique, dans le titre V intitulé Les Associations des fidèles (CIC 298-329). Ces normes établissent les dispositions générales qui gouvernent l’organisation et le fonctionnement des associations de fidèles, y compris les confréries. Les confréries acquièrent une personnalité juridique distincte de celle des différents affiliés. En Italie, la Conférence Épiscopale Italienne a érigé la Confédération des Confréries des Diocèses d’Italie avec un décret propre daté du 14 avril 2000. Cette association réunit la plupart des confréries italiennes et a pour but de favoriser la coopération et le partage d’expériences entre elles.
Chaque confrérie doit être dédiée à un saint ou à un mystère de la foi, qui représente le focus spirituel de la confrérie et inspire ses activités. Un but spécifique à poursuivre doit également être déclaré, but qui peut être lié à la prière, à l’adoration, à l’assistance caritative, à la promotion de la dévotion pour un aspect particulier de la foi ou à d’autres objectifs spirituels et pastoraux. La confrérie peut avoir un siège physique qui peut être une église, un oratoire ou un autel à l’intérieur d’une église paroissiale ou d’un autre lieu de culte. Le siège est le lieu où la confrérie mène des activités et célèbre ses cérémonies.
La confrérie est officiellement instituée par un décret de l’autorité ecclésiastique compétente. Cette autorité peut être le Pape, la Conférence Épiscopale, l’Évêque ou le Doyen d’un institut religieux.

Les questions internes à la confrérie doivent être réglées par un statut interne approuvé par l’autorité ecclésiastique compétente, qui règle les aspects organisationnels, les normes de participation, les devoirs des membres. Les confrères et les consœurs portent un habit liturgique particulier pendant les cérémonies et les processions. L’habit peut varier selon la religion, mais possède une coupe et une couleur précises qui identifient l’appartenance à la confrérie.
Les confréries sont gérées par une administration interne, appelée conseil ou gouvernement, qui est composée de différentes figures : le Prieur, chef de la confrérie et responsable de son guide et de sa direction ; un ou deux vicaires, qui l’assistent ; différentes figures qui jouent des rôles spécifiques à l’intérieur de la confrérie, comme le secrétaire, le trésorier, les pourvoyeurs, le fiscaliste et d’autres ; des conseillers, les membres du conseil. En outre, chaque confrérie doit avoir un Assistant Spirituel, qui est un prêtre ou un religieux nommé par l’autorité ecclésiastique compétente.
Pour arriver à faire partie d’une confrérie, un an de noviciat est généralement prévu, année pendant laquelle le candidat participe à la vie de la confrérie et dont le comportement est évalué par le conseil. Après avoir terminé leur année de noviciat, les nouveaux membres participent à une messe solennelle, pendant laquelle ils jurent devant Dieu et tous leurs confrères, sont bénits et reçoivent la cape consacrée, qu’ils pourront porter lors des processions et des célébrations.
Différence entre Confrérie et Archiconfrérie
Après 1530, surtout à Rome, commencèrent à se former aussi les archiconfréries, composées de différentes confréries reliées entre elles. Une confrérie pouvait se joindre à une autre en envoyant une présentation officielle de statuts et une lettre de l’évêque qui attestait sa légitimité canonique. Ce fut Pape Clément VIII qui imposa ce prérequis à la fin du XVIe siècle afin de garantir l’ordre et la régularité des associations.
Le XVIe siècle fut une période de grande prospérité pour les confréries italiennes, en particulier pour les archiconfréries, également appelées « confréries mères ». Elles avaient le droit d’agréger les compagnies locales, qui recevaient toutes les indulgences et les privilèges concédés à l’archiconfrérie mère de référence.
Confrérie du Gonfalone
L’histoire du Gonfalone, confrérie romaine, a des racines anciennes. Originairement appelée « Recommandés de Madone Ste Marie », fut reconnue par pape Clément IV en 1267 et avait son siège auprès de la Basilique de Sainte-Marie-Majeure. En 1351, elle changea de nom en « Recommandés du Gonfalone ». Dans la deuxième moitié du XVe siècle, la compagnie des Recommandés de Madone Ste Marie s’unit à une autre confrérie déjà présente dans la basilique, en donnant vie à la Confrérie du Gonfalone.
La Confrérie du Gonfalone fut élevée au titre d’Archiconfrérie en 1579 grâce au pape Grégoire XIII. Deux ans après, le pontife leur confia l’œuvre pieuse de la rançon des personnes capturés par les corsaires barbaresques dans la péninsule italienne, pour les libérer et les faire retourner à leurs familles. Cette œuvre pieuse de récolte de fonds pour la rançon des prisonniers devint l’activité principale de la confrérie pendant le XVIIe et le XVIIIe siècle.
Après sa suppression à l’époque napoléonienne, le Gonfalone de Rome reprit ses activités en 1823, mais, au cours du temps, il se redimensionna et tomba dans un état d’inactivité, en maintenant vif le souvenir à travers son magnifique oratoire. En décembre 2010, l’Archiconfrérie romaine a repris son activité sur décret du Cardinal Vicaire, en mettant à jour les anciens statuts et en reprenant avec douze confrères fondateurs en mémoire de la fondation d’origine.
Confrérie du Très-Saint-Sacrement
L’Archiconfrérie du Très-Saint-Sacrement est une confrérie catholique dédiée à la vénération et à la préservation du culte eucharistique. Les origines de cette confrérie remontent à une période incertaine. Il existe des indices de sa fondation déjà en 1539, mais la source n’est pas certaine.
Pendant la Contre-réforme, l’Église catholique voulut réaffirmer la présence réelle de Christ dans l’Eucharistie de toutes les manières possibles. De nombreuses confréries modifièrent leur nom original de « Corps de Christ » à « Très-Saint-Sacrement », considéré comme plus adapté pour diffuser la doctrine catholique sur la présence eucharistique. Ce fut probablement le cas aussi pour la confrérie du Corps de Christ à Vico del Gargano.
Confrérie du Très Saint Crucifix
Instituée à Alexandrie au XIIIe siècle, la vénérable Confrérie du Très Saint Crucifix à San Giovannino fait partie des mouvements pénitentiels que nous avons mentionnés.
Une Archiconfrérie du Très Saint Crucifix fut par contre instituée en 1591 auprès de la Cathédrale d’Agrigente. Sa fondation est liée à la dévotion pour Jésus Crucifié. La dénomination officielle de la confrérie était « Très Saint Crucifix de la Charité », pour souligner également l’aspect caritatif de ses initiatives. Outre la dévotion pour le Crucifix, la confrérie se dédiait à l’œuvre spéciale de charité en faveur des détenus, des ex-détenus et à d’autres bonnes œuvres.
Avec l’approbation et la confirmation de la Curie Épiscopale, la confrérie devint Archiconfrérie et, ensuite, fut affiliée à l’Archiconfrérie du Très Saint Crucifix de San Marcello à Rome.

Confrérie de la Miséricorde
En général, les Miséricordes sont des confréries et archiconfréries d’origine catholique dédiées à l’assistance aux nécessiteux. En Italie, on trouve des sources qui font remonter la fondation de la Miséricorde de Florence, une des plus anciennes, à 1244. De nombreuses Miséricordes se dédiaient également au soin des pèlerins, ou à l’assistance des condamnés à mort.
Aujourd’hui, en Italie, plus de 700 Confréries de Miséricorde sont encore actives, réunies depuis 1899 dans la Confédération Nationale des Miséricordes d’Italie. Leurs activités de bénévolat vont du secours sanitaire en ambulance à la gestion de centres sociaux et résidences pour personnes âgées, à la Protection Civile.













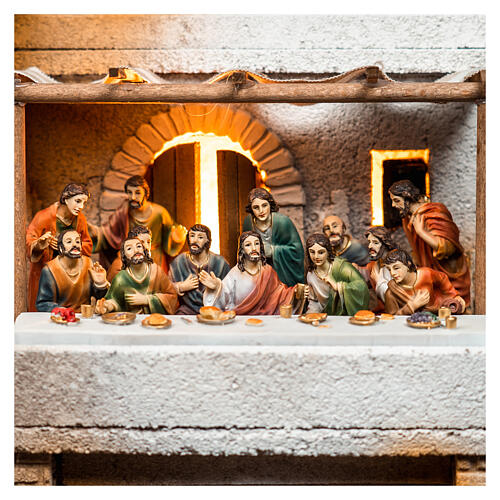




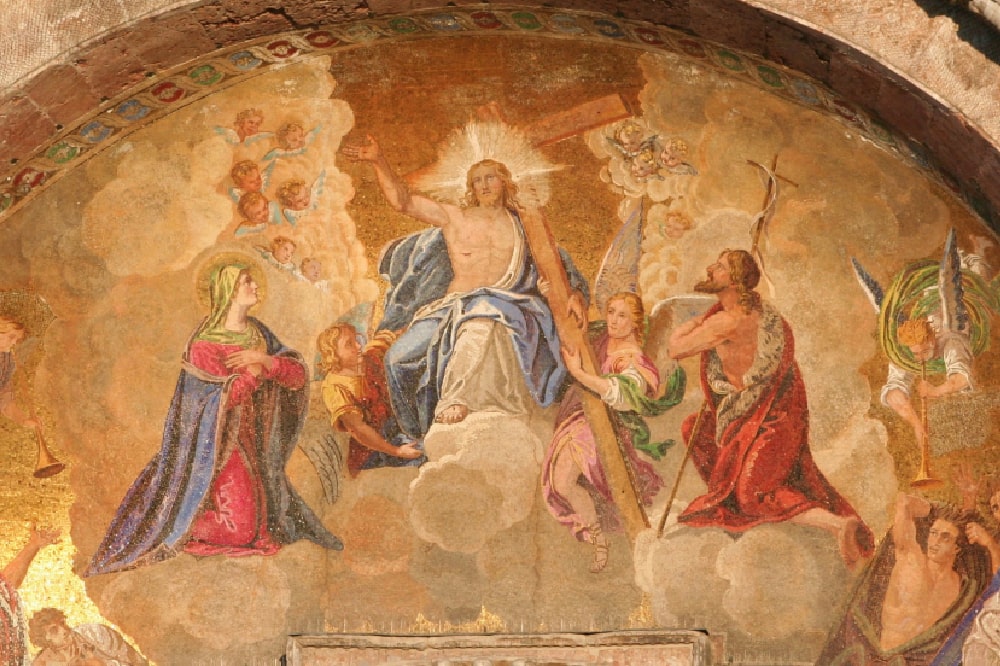
 5 mai 2025
5 mai 2025


